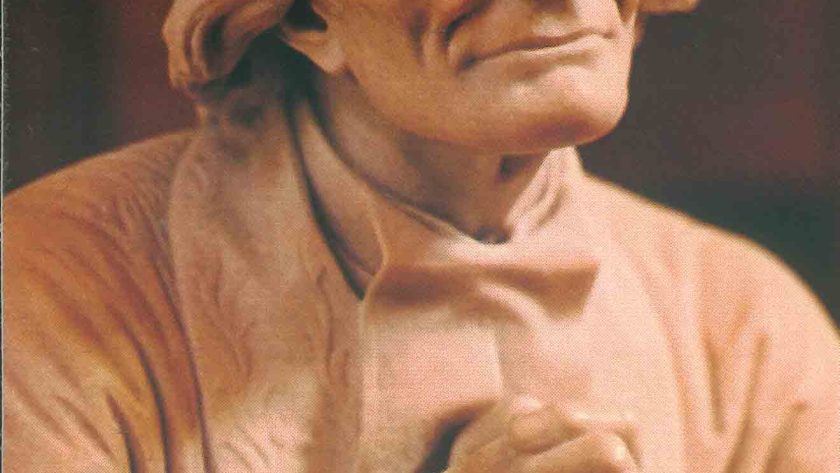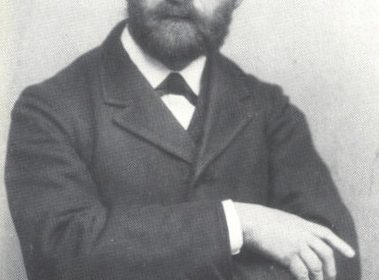patron de tous les curés du monde
1786-1859
prêtre franciscain séculier
Jean-Marie Vianney
Au soir du 19 février 1818, après avoir parcouru à pied les trente kilomètres qui séparent Écully du village d’Ars (près de Lyon), Jean-Marie Vianney, jeune prêtre, demande le chemin de sa nouvelle paroisse à un petit berger. Celui-ci remet sur la voie cet inconnu, et entend comme remerciement: «Mon petit ami, tu m’as montré le chemin d’Ars; je te montrerai le chemin du Ciel».
UN PETIT BERGER SOUS LA TERREUR
1793. La Terreur. À Lyon, sur la place des Terreaux, la guillotine ne chôme pas. Les églises sont closes. Sur les chemins, il n’y a plus que le socle des calvaires: des hommes venus de Lyon ont abattu les croix. Seul, chez les vrais fidèles, le sanctuaire des cœurs demeure inviolé. Jean-Marie Vianney, né en 1786, passe ses jeunes années dans ce climat de révolution.
Il garde avec beaucoup de précautions une statuette de la Sainte Vierge, l’emportant même aux champs, dans une poche de sa blouse. Il la place dans le tronc d’un vieil arbre, l’entoure de mousses, de branchages et de fleurs, puis, les genoux dans l’herbe, égrène son chapelet. Les bords du ruisseau ont remplacé l’église désaffectée où personne ne prie plus. D’autres bergers gardent leurs troupeaux aux alentours. Cette compagnie n’est pas toujours sage; mais Jean-Marie ne peut l’empêcher de venir à lui. Et voilà que, sans y penser, il devient apôtre. Catéchiste de ses camarades, il redit ce qu’il a entendu lui-même dans le silence des nuits, et enseigne les prières qu’il a apprises de sa mère. Une vocation sacerdotale vient d’éclore: au profond de son âme se fait entendre ce suis-moi (Mt 8, 22) qui, sur la rive du lac de Galilée, attira Pierre, André, Jacques et Jean à la suite de Jésus.
À 19 ans, il commence ses études de séminariste. Hélas! la grammaire latine lui paraît rébarbative. Le jeune homme a la répartie vive et fine; on aime l’entendre parler, mais les études sont difficiles; dès qu’il tient une plume entre les doigts, il devient lent, embarrassé. Au grand séminaire de Lyon, ses efforts semblent stériles. L’épreuve est grande quand, au bout de cinq ou six mois, les directeurs, croyant qu’il ne peut réussir, le prient de se retirer. Beaucoup de ses condisciples sont très affligés de le voir quitter le séminaire. Profondément peiné lui-même, il se confie à la Providence. Après une longue et studieuse attente, son directeur spirituel le présente à l’un des vicaires généraux, M. Courbon, qui gouverne l’archidiocèse de Lyon:
«L’abbé Vianney est-il pieux? demande celui-ci. A-t-il de la dévotion envers la Sainte Vierge? Sait-il dire son chapelet? – Oui, c’est un modèle de piété. – Un modèle de piété! Eh bien, je l’appelle. La grâce de Dieu fera le reste… L’Église n’a pas besoin seulement de prêtres savants, mais encore et surtout de prêtres pieux».
M. Courbon est bien inspiré. Par la grâce de Dieu et un travail assidu, l’abbé Vianney accomplit de réels progrès dans ses études. Lors de l’examen canonique en vue du sacerdoce, l’examinateur l’interroge pendant plus d’une heure sur les points les plus difficiles de la théologie morale. Ses réponses nettes et précises donnent entière satisfaction. Toute sa vie, le saint Curé attachera une grande importance à la connaissance de la saine doctrine. Il préparera avec soin ses sermons. Pour entretenir ses connaissances, il se remettra à l’étude les soirs d’hiver.
L’OBSESSION DU SALUT DES ÂMES
L’accès au sacerdoce est désormais ouvert à l’abbé Vianney qui reçoit la prêtrise le 13 août 1815. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par Lui le monde soit sauvé (Jn 3, 17). La mission des prêtres est précisément de rendre cette œuvre de salut présente et efficiente partout dans le monde. C’est pourquoi le Curé d’Ars pourra dire: «Sans le prêtre, la mort et la Passion de Notre-Seigneur ne serviraient à rien. C’est le prêtre qui continue l’œuvre de la Rédemption sur la terre».
À l’image du Bon Pasteur, il va passer sa vie à rechercher les brebis perdues pour les ramener à la bergerie. «Si un pasteur reste muet en voyant Dieu outragé et les âmes s’égarer, dira-t-il un jour, malheur à lui!» Il a un attrait particulier pour la conversion des pécheurs. Ses gémissements sur la perte des âmes fendent le coeur: «Encore si le Bon Dieu n’était pas si bon, mais Il est si bon!… Sauvez votre pauvre âme! Que c’est dommage de perdre une âme qui a tant coûté à Notre-Seigneur! Quel mal vous a-t-il donc fait pour le traiter de la sorte?» Il fait un jour une instruction mémorable sur le jugement dernier, répétant à plusieurs reprises au sujet des damnés : «Maudit de Dieu! Maudit de Dieu! Quel malheur, quel malheur!» Ce ne sont plus des paroles mais des sanglots qui arrachent des larmes à tous ceux qui sont présents.
Autant qu’il le peut, il se rend disponible pour offrir aux âmes repenties le pardon de Dieu. Il a, en effet, une grande horreur du mal: «Par le péché, nous chassons le Bon Dieu de nos âmes, nous méprisons le Bon Dieu, nous Le crucifions, nous défions sa justice, nous contristons son cœur paternel, nous Lui ravissons des adorations, des hommages qui ne sont dus qu’à Lui… Le péché jette dans notre esprit des ténèbres affreuses qui bouchent les yeux de l’âme, il obscurcit la foi comme les brouillards épais obscurcissent le soleil à nos yeux… Il nous empêche d’aller au ciel. Oh! que le péché est un grand mal!» C’est pour cela qu’il emploie un temps considérable à administrer le sacrement de Pénitence, moyen ordinaire pour retrouver l’état de grâce et l’amitié du Seigneur.
UN CONFESSIONNAL ASSIÉGÉ
«Le grand miracle du Curé d’Ars, a-t-on pu dire, c’est son confessionnal assiégé nuit et jour». Le saint vit dans cet étroit réduit les trois quarts de son existence: de novembre à mars, il n’y passe pas moins de 11 à 12 heures chaque jour, et pendant la belle saison, de 16 à 18 heures. L’hiver, quand ses doigts craquelés d’engelures sont trop engourdis, il enflamme vaille que vaille un bout de journal pour les réchauffer. Quant à ses pieds, de son propre aveu, «de la Toussaint à Pâques, je ne les sens pas!» Cela est si vrai qu’il lui arrive, le soir, en retirant ses bas, d’enlever en même temps la peau de ses talons. Mais que lui importent ses souffrances, pour sauver des âmes, il est prêt à tout.
«Pour bien effacer ses péchés, il faut bien se confesser!» a-t-il l’habitude de dire. « Bien se confesser »: cela signifie d’abord qu’il faut se préparer par un examen de conscience sérieux. Le Pape Jean-Paul II a rappelé que «la confession doit être complète en ce sens qu’elle doit énoncer tous les péchés mortels… Aujourd’hui, de nombreux fidèles s’approchant du sacrement de la Pénitence ne s’accusent pas entièrement des péchés mortels, et, parfois, ils s’opposent au prêtre confesseur, qui, conformément à son devoir, les interroge pour parvenir à une description exhaustive et nécessaire des péchés, comme s’il se permettait une intrusion injustifiée dans le sanctuaire de la conscience. Je souhaite et prie pour que ces fidèles peu éclairés soient convaincus que la règle selon laquelle on exige l’énumération spécifique et exhaustive des péchés, dans la mesure où la mémoire interrogée de façon honnête permet de s’en souvenir, n’est pas un poids qui leur est imposé arbitrairement, mais un moyen de libération et de sérénité» (Allocution aux étudiants en théologie morale, le 22 mars 1996).
«Le péché lie l’homme avec ses liens honteux», enseigne le saint Curé. Selon le mot de Notre-Seigneur: Celui qui commet le péché est esclave du péché (Jn 8, 34). En effet, le péché crée un entraînement au péché; il engendre le vice et obscurcit la conscience (cf. Catéchisme de l’Église Catholique, 1865). L’absolution sacramentelle, reçue avec les dispositions requises, rend à l’âme la vraie liberté intérieure et lui donne des forces pour vaincre les mauvaises habitudes. «C’est beau de penser que nous avons un sacrement qui guérit les plaies de notre âme!» s’exclame saint Jean-Marie Vianney. «Dans le sacrement de Pénitence, dit-il encore, Dieu nous montre et nous fait part de sa miséricorde jusqu’à l’infini… Vous avez vu ma chandelle: cette nuit, ce matin elle a fini de brûler. Où est-elle? Elle n’existe plus, elle est anéantie: de même les péchés dont on a reçu l’absolution n’existent plus: ils sont anéantis».
Le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable « résurrection spirituelle », une restitution de l’amitié divine. Un des fruits secondaires en est la joie de l’âme, la paix de la conscience. Ils sont nombreux, les pénitents d’Ars, à l’avoir expérimenté. L’un d’eux, vieillard incrédule qui ne s’était pas confessé depuis plus de trente ans, avoua après l’aveu de ses fautes avoir ressenti «un bien-être indéfinissable».
La bonté du saint envers les pécheurs ne tourne pas en faiblesse. Avant de donner l’absolution, il exige des indices suffisants de conversion. Deux choses sont absolument nécessaires: tout d’abord la contrition, c’est-à-dire «la douleur d’avoir péché, fondée sur des motifs surnaturels, car le péché viole la charité envers Dieu, Bien suprême, il a causé les souffrances du Rédempteur et il nous occasionne la perte des Biens éternels» (Jean-Paul II, ibid.). Le saint Curé reprend un jour un pénitent mal disposé, en ces termes: «Votre repentir ne vient pas de Dieu, ni de la douleur de vos péchés, mais seulement de la crainte de l’enfer». Le ferme propos de ne plus pécher est tout autant nécessaire. «Il est en outre évident que l’accusation des péchés doit comprendre l’intention sérieuse de ne plus en commettre à l’avenir. Si cette disposition de l’âme venait à manquer, il n’y aurait pas en réalité de repentir» (JP II, ibid.). L’intention de ne plus pécher implique la volonté de mettre en œuvre les moyens appropriés et, si nécessaire, le renoncement à certains comportements. À cet égard, le Curé d’Ars manifeste une fermeté qui lui vaut des critiques, par exemple lorsqu’il exige de ses pénitents l’abandon de la danse et des tenues vestimentaires indécentes.
CONFIANCE EN LA GRÂCE
«L’intention de ne pas pécher doit se fonder sur la grâce divine que le Seigneur ne refuse jamais à celui qui fait ce qui est en son pouvoir pour agir honnêtement. Nous attendons de la Bonté divine, en raison de ses promesses et des mérites de Jésus-Christ, la vie éternelle et les grâces nécessaires pour l’obtenir» (Jean-Paul II, ibid.). Le saint Curé encourage ses pénitents à puiser aux sources de la grâce: «Il y a deux choses pour s’unir avec Notre-Seigneur et pour faire son salut: la prière et les sacrements». Avec la grâce tout devient possible et même facile.
C’est à la communion eucharistique que saint Jean-Marie Vianney veut surtout conduire ses fidèles. Communier, c’est recevoir le Christ lui-même et augmenter notre union avec Lui. Cela suppose l’état de grâce: «Celui qui veut recevoir le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu’un a conscience d’avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l’Eucharistie sans avoir reçu préalablement l’absolution dans le sacrement de Pénitence» (CEC, 1415). Aux âmes bien disposées et désireuses de progresser, le Curé d’Ars, contrairement à la coutume de son époque, conseille de communier fréquemment: «La nourriture de l’âme, c’est le corps et le sang d’un Dieu! ô la belle nourriture! l’âme ne peut se nourrir que de Dieu! il n’y a que Dieu qui puisse la remplir! il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim! il lui faut absolument son Dieu! allez donc à la communion, allez à Jésus avec amour et confiance!»
Lui-même a fait de l’Eucharistie le centre de sa vie. On sait la place que tient la Messe dans chacune de ses journées, avec quel soin il s’y prépare et la célèbre. Il encourage aussi beaucoup les visites au Saint-Sacrement, et aime à raconter l’anecdote suivante: «Il y avait ici, dans la paroisse, un homme qui est mort voilà quelques années. Entré le matin dans l’église pour faire sa prière avant d’aller dans les champs, il laissa sa pioche à la porte et s’oublia là devant Dieu. Un voisin, qui travaillait vers le même endroit et qui avait l’habitude de l’apercevoir, fut étonné de son absence. S’en retournant, il s’imagina de pénétrer dans l’église, pensant qu’il y serait peut-être. Il l’y trouva en effet. « Que fais-tu là si longtemps? » lui demanda-t-il. L’autre lui répondit: « J’avise le bon Dieu, et le bon Dieu m’avise »».
MA PLUS VIEILLE AFFECTION
En même temps qu’à l’Eucharistie, le saint Curé conduit les âmes à la Sainte Vierge, la Mère de miséricorde et le Refuge des pécheurs. Il reste de nombreuses heures en prière au pied de son autel. Dans ses catéchismes, ses prédications, ses entretiens, il en parle de l’abondance du cœur: «La Très Sainte Vierge se tient entre son Fils et nous. Plus nous sommes pécheurs et plus elle a de tendresse et de compassion pour nous. L’enfant qui a coûté le plus de larmes à sa mère est le plus cher à son cœur. Une mère ne court-elle pas toujours au plus faible et au plus exposé? Un médecin, dans un hôpital, n’a-t-il pas plus d’attention pour les plus malades?» Il confie, un jour, à Catherine Lassagne, une de ses filles spirituelles, franciscaine séculière: «Je l’ai aimée [la Vierge] avant même de la connaître; c’est ma plus vieille affection!» La Très Sainte Vierge est la lumière de ses jours sombres. Le 8 décembre 1854, le Pape Pie IX définit le dogme de l’Immaculée Conception. Malgré sa fatigue, le Curé d’Ars tient à chanter lui même la grand-messe. L’après-midi, à l’issue des Vêpres, toute la paroisse se rend en procession à l’école des Frères où il bénit une statue de l’Immaculée installée dans le jardin et dont il est le donataire. Le soir, dans le village, on illumine le clocher, les murs de l’église, les façades des maisons. Cette fête est vraiment l’un des plus beaux jours de sa vie. Presque septuagénaire, il paraît rajeuni de vingt ans. Jamais enfant ne fut plus heureux de voir triompher sa mère: «Quel bonheur, quel bonheur! J’ai toujours pensé qu’il manquait ce rayon à l’éclat des vérités catholiques. C’est une lacune qui ne pouvait pas demeurer dans la religion».
« JE ME REPOSERAI EN PARADIS »
Dans son amour pour les âmes, saint Jean-Marie Vianney n’oublie pas les pauvres. Il fonde un foyer pour les jeunes filles abandonnées, qu’il appelle: « la Providence ». Cet établissement reçoit cinquante ou soixante jeunes filles, de douze à dix-huit ans. Venues de toutes les régions et reçues sans argent, elles passent là un temps indéterminé, puis sont placées dans les fermes du pays. Pendant leur séjour, elles apprennent à connaître, à aimer, à servir Dieu. Elles forment une famille, dans laquelle les aînées donnent exemple, conseil et enseignement aux plus jeunes. Il ne s’agit pas d’une institution ordinaire, mais plutôt d’une émanation de la sainteté du fondateur. Ressources, vie, esprit et gouvernement viennent de lui.
Mais les âmes ne se sauvent pas sans beaucoup de souffrances. Des contradictions, des croix, des luttes, des embûches, viennent de toutes parts au saint Curé, tant du côté des hommes que du côté du « Grappin » (sobriquet par lequel il désigne habituellement le démon). Sa vie est un combat contre les forces du mal. Pour le soutenir il n’a de ressource que sa patience, ses prières et son jeûne qui dépasse parfois les limites de la prudence humaine. Il développe la vertu de douceur au point de faire croire qu’il est sans passions et incapable de s’emporter. Cependant les personnes qui le voient de plus près et fréquemment s’aperçoivent assez vite qu’il a l’imagination vive, le caractère bouillant. Parmi les preuves étonnantes de sa patience, on raconte qu’un homme d’Ars se rendit au presbytère pour l’accabler d’insultes: il le reçoit, l’écoute sans un mot, puis l’accompagne par politesse et lui donne l’accolade avant de le quitter. Le sacrifice lui coûte tant qu’il remonte aussitôt dans sa chambre et doit se mettre sur son lit. Son corps est couvert de boutons, à cause de la violence qu’il a dû se faire…
Cette patience héroïque, le saint la doit à son amour pour Jésus-Christ. Notre-Seigneur est sa vie, son ciel, son présent, son avenir, et l’adorable Eucharistie est le seul étanchement possible à la soif qui le consume. «O Jésus! s’écrie-t-il souvent, les yeux remplis de larmes, vous connaître, c’est vous aimer… Si nous savions comme Notre-Seigneur nous aime, nous mourrions de plaisir! Je ne crois pas qu’il y ait des cœurs assez durs pour ne pas aimer en se voyant tant aimés… C’est si beau la charité! C’est un écoulement du Cœur de Jésus, qui est tout amour… Le seul bonheur que nous ayons sur la terre, c’est d’aimer Dieu et de savoir que Dieu nous aime…»
Arrivé au terme de sa vie, dont nous n’avons rapporté que quelques traits, le saint Curé aspire ardemment au Ciel. «Nous le verrons! nous le verrons! ô, mes frères! y avez-vous jamais pensé? nous verrons Dieu! nous le verrons tout de bon! nous le verrons tel qu’Il est face à face! nous le verrons! nous le verrons!!!» avait-il dit un jour. Comme l’ouvrier qui a bien rempli sa tâche, il part voir Dieu et se reposer en paradis le 4 août 1859.
D’après Dom Antoine Marie osb, abbé Source : www.clairval.com
La prière du Curé d’Ars
Je vous aime, ô mon Dieu,
Et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,
et j’aime mieux mourir en vous aimant,
que de vivre un seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, Seigneur,
et la seule grâce que je vous demande,
c’est de vous aimer éternellement…
Mon Dieu,
si ma langue ne peut dire à tous moments que je vous aime,
je veux que mon cœur vous le répète
autant de fois que je respire…
Mon Dieu, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant
et de vous aimer en souffrant.
Je vous aime, ô mon Divin Sauveur,
parce que vous avez été crucifié pour moi ;
Je vous aime, ô mon Dieu,
parce que vous me tenez ici-bas crucifié pour vous…
Mon Dieu, faites-moi la grâce
de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime.
Mon Dieu, à proportion que je m’approche de ma fin,
Faites-moi la grâce d’augmenter mon amour
et de me perfectionner. Amen !
Voici le récit de Mgr Henri Convert
concernant la vocation franciscaine séculière de Jean-Marie Vianney.
Il fut un grand connaisseur du Saint, ce document est du plus grand intérêt:
« Une des gloires du Père Léonard ofmCap. est d’avoir été le confident, l’ami, le directeur du Curé d’Ars. C’est lui qui l’a soutenu, aidé, encouragé au moment où il éprouvait les plus rudes assauts du démon. Le Vénérable Abbé Vianney, tourmenté par le désir de se faire religieux capucin, et craignant de ne pouvoir sauver son âme au milieu de ces foules qui envahissaient sa petite paroisse, venait trouver notre bon Père Léonard à Lyon, au couvent des Brotteaux, pour recevoir ses conseils. Mais toujours notre saint religieux le détournait de ses projets. Il l’obligeait à retourner à son labeur apostolique, en lui disant qu’il n’était pas appelé à être capucin, et que le bon Dieu le voulait à Ars, où il sauverait beaucoup plus d’âmes. Consolé, fortifié par les paroles du Père, le saint Curé reprenait à pied le chemin de sa paroisse. Un jour, plus triste que de coutume devant le bruit qui se faisait autour de sa personne, il vint se lamenter et conjura de nouveau le Père Léonard de le faire accepter dans l’Ordre de Saint François. Le saint religieux, plein d’expérience, et animé de l’Esprit de Dieu, s’y refusa formellement. Cependant, pour satisfaire son pieux désir de vie religieuse, il lui parla du Tiers-Ordre, et le reçut quelque temps après ; bien plus, afin de le consoler davantage, il alla lui-même à Ars pour y établir une Fraternité Séculière du Tiers-Ordre.
En 1891, cédant aux instances du Père Ephrem, le Père Léonard alla, malgré ses 80 ans, revoir la commune d’Ars pour y entendre Mgr Freppel et y voir deux franciscaines séculières contemporaines du saint Curé, qu’il avait reçues dans l’Ordre Franciscain Séculier, le jour de l’érection de la Fraternité. C’est alors qu’il profita de l’occasion pour dresser un procès-verbal dont voici la teneur :
« Je soussigné, certifie avoir reçu dans le Tiers-Ordre de Saint François d’Assise, au couvent des Brotteaux, à Lyon, en l’an 1847, Monsieur Jean-Baptiste Vianney, curé d’Ars, et l’avoir admis à la Profession, l’année suivante, à Ars, dans son église où j’ai établi le Tiers-Ordre, en le nommant Directeur.
En foi de quoi je délivre la présente attestation.
Le 4 août 1891. Fr. Léonard, capucin. »
***
Le 4 août 1859 : entrée dans la vie du Saint Curé d’Ars
Le 3 octobre 1872 : le Pape Pie IX le déclare vénérable
Le 8 janvier 1905 : le Pape Pie X le déclare bienheureux
Le 31 mai 1925 : le Pape Pie XI le canonise en la solennité de Pentecôte.
Et proclame Jean-Marie Vianney curé d’Ars :
« Patron de tous les curés du monde »
Ce que prêchait le Curé d’Ars (p. 32-36)
Laissez-vous conduire par l’Esprit.
Oh, que c’est beau, mes enfants ! Le Père est notre Créateur, le Fils est notre Rédempteur, et le Saint Esprit, notre conducteur
L’homme n’est rien par lui-même, mais il est beaucoup avec l’Esprit Saint.
L’homme est tout terrestre et tout animal ; il n’y a que le Saint Esprit qui puisse élever son âme et le porter en haut. Quand on est conduit par un Dieu de force et de lumière, on ne peut pas se tromper. L’Esprit Saint est une lumière et une force. C’est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le Saint Esprit nous fait voir le bien et le mal en grand. Avec le Saint Esprit, on voit tout en grand !
Les gens du monde n’ont pas l’Esprit Saint ; ou s’ils l’ont, ils ne l’ont qu’en passant ; il ne s’arrête pas chez eux : le bruit du monde le fait partir. Un chrétien qui est conduit par l’Esprit Saint n’a pas de peine à laisser les biens de ce monde pour courir après les biens du Ciel, il sait faire la différence. L’œil du monde ne voit pas plus loin que la vie… L’œil du chrétien voit jusqu’au fond de l’éternité.
C’est le Saint Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans leur bouche… Ceux qui ont le Saint Esprit ne produisent rien de mauvais; aussi lorsqu’on sent que la ferveur se perd, il faut vite faire une neuvaine au Saint Esprit pour demander la foi et l’amour… – Voyez ! Lorsqu’on a fait une retraite ou un jubilé, on est plein de bons désirs. Ces désirs sont le souffle de l’Esprit Saint qui a passé sur notre âme et qui a tout renouvelé, comme ce vent chaud qui fond la glace et qui ramène le printemps…
Vous qui n’êtes pas cependant de grands saints, vous avez bien des moments où vous goûtez les douceurs de la prière et de la présence de Dieu : ce sont des visites du Saint Esprit. Il y en a qui trouvent la religion ennuyeuse, c’est qu’ils n’ont pas le Saint Esprit. Si l’on disait aux saints : « Pourquoi êtes-vous au Ciel ? », ils répondraient : « Pour avoir écouté le Saint Esprit ». Quand il nous vient de bonnes pensées, c’est le Saint Esprit qui nous visite. Le Saint Esprit est une force.
Le Bon Dieu, en nous envoyant le Saint Esprit, a fait à notre égard comme un grand roi qui chargerait son ministre de conduire un de ses sujets, disant : « Vous accompagnerez cet homme partout, et vous me le ramènerez sain et sauf. » – Que c’est beau, mes enfants, d’être accompagné par le Saint Esprit! C’est un bon guide, celui-là… Et dire qu’il y en a qui ne veulent pas le suivre ! Le Saint Esprit est comme un homme qui aurait une voiture avec un bon cheval et qui voudrait nous mener à Paris. Nous n’aurions qu’à dire oui et à monter dedans ! … C’est une bien belle affaire que de dire oui ! ! Eh bien, le Saint Esprit veut nous mener au Ciel: nous n’avons qu’à dire oui et à nous laisser conduire.
Le Saint Esprit est comme un jardinier qui travaille notre âme… Le Saint Esprit est notre domestique ! – Voilà un fusil : bon ! – Vous le chargez… Mais il faut quelqu’un pour y mettre le feu et pour le faire partir… De même il y a en nous de quoi faire le bien… C’est le Saint Esprit qui met le feu et les bonnes œuvres partent.
Le Saint Esprit se repose dans les âmes justes, comme la colombe dans son nid. Il couve les bons désirs dans une âme pure, comme la colombe couve ses petits. L’Esprit Saint nous conduit comme une mère conduit son enfant de deux ans par la main… comme une personne qui y voit conduit un aveugle.
Il faudrait dire chaque matin : « Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes ».
Du Pape BENOÎT XVI
Mercredi 5 août 2009
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
Dans la catéchèse d’aujourd’hui, je voudrais reparcourir brièvement l’existence du saint curé d’Ars en soulignant certains traits de celle-ci, qui peuvent servir d’exemple aux prêtres de notre époque, assurément différente de celle où il vécut, mais marquée, sous de nombreux aspects, par les mêmes défis humains et spirituels fondamentaux. C’est précisément hier que l’on fêtait les cent cinquante ans de sa naissance au ciel: il était en effet deux heures du matin le 4 août 1859, lorsque saint Jean Baptiste Marie Vianney, au terme de son existence terrestre, alla à la rencontre du Père céleste pour recevoir en héritage le royaume préparé depuis la création du monde pour ceux qui suivent fidèlement ses enseignements (cf. Mt25, 34). Quelle grande fête il dut y avoir au Paradis pour l’arrivée d’un pasteur si zélé! Quel accueil doit lui avoir réservé la multitude des fils réconciliés avec le Père, grâce à son œuvre de curé et de confesseur! J’ai voulu saisir l’occasion de cet anniversaire pour proclamer l’Année sacerdotale qui, comme on le sait, a pour thème: Fidélité du Christ, fidélité du prêtre. C’est de la sainteté que dépend la crédibilité du témoignage et, en définitive, l’efficacité même de la mission de chaque prêtre.
Jean-Marie Vianney naquit dans le petit village de Dardilly le 8 mai 1786, dans une famille de paysans, pauvre en biens matériels, mais riche d’humanité et de foi. Baptisé, comme le voulait le bon usage à l’époque, le jour même de sa naissance, il consacra les années de l’enfance et de l’adolescence aux travaux dans les champs et à paître les animaux, si bien qu’à l’âge de dix-sept ans, il était encore analphabète. Mais il connaissait par cœur les prières que lui avait enseignées sa pieuse mère et il se nourrissait du sentiment religieux que l’on respirait chez lui. Les biographes racontent que, dès sa prime jeunesse, il essaya de se conformer à la divine volonté même dans les tâches les plus humbles. Il nourrissait dans son âme le désir de devenir prêtre, mais il ne lui fut pas facile de le satisfaire. Il parvint en effet à l’ordination sacerdotale après de nombreuses adversités et incompréhensions, grâce à l’aide de sages prêtres, qui ne s’arrêtèrent pas à considérer ses limites humaines, mais surent regarder au-delà, devinant l’horizon de sainteté qui se profilait chez ce jeune homme véritablement singulier. Ainsi, le 23 juin 1815, il fut ordonné diacre et le 13 août suivant, prêtre. Enfin, à l’âge de 29 ans, après de nombreuses incertitudes, un certain nombre d’échecs et beaucoup de larmes, il put monter sur l’autel du Seigneur et réaliser le rêve de sa vie.
Le saint curé d’Ars manifesta toujours une très haute considération du don reçu. Il affirmait: « Oh! Quelle grande chose que le sacerdoce! On ne le comprendra bien qu’une fois au Ciel.. si on le comprenait sur la terre, on mourrait, non d’effroi mais d’amour! » (Abbé Monnin, Esprit du Curé d’Ars, p. 113). En outre, dans son enfance, il avait confié à sa mère: « Si j’étais prêtre, je voudrais conquérir beaucoup d’âmes » (Abbé Monnin,Procès de l’ordinaire, p. 1064). Et il en fut ainsi. Dans le service pastoral, aussi simple qu’extraordinairement fécond, ce curé anonyme d’un village isolé du sud de la France parvint si bien à s’identifier à son ministère, qu’il devint, également de manière visible et universellement reconnaissable, alter Christus, image du Bon Pasteur, qui à la différence du mercenaire, donne la vie pour ses brebis (cf. Jn 10, 11). A l’exemple du Bon Pasteur, il a donné la vie au cours des décennies de son service sacerdotal. Son existence fut une catéchèse vivante, qui trouvait une efficacité toute particulière lorsque les personnes le voyaient célébrer la Messe, s’arrêter en adoration devant le tabernacle ou passer de longues heures dans le confessionnal.
Au centre de toute sa vie, il y avait donc l’Eucharistie, qu’il célébrait et adorait avec dévotion et respect. Une autre caractéristique fondamentale de cette extraordinaire figure sacerdotale, était le ministère assidu des confessions. Il reconnaissait dans la pratique du sacrement de la pénitence l’accomplissement logique et naturel de l’apostolat sacerdotal, en obéissance au mandat du Christ: « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (cf. Jn 20, 23). Saint Jean-Marie Vianney se distingua donc comme un confesseur et maître spirituel excellent et inlassable. En passant « d’un même mouvement intérieur, de l’autel au confessionnal », où il passait une grande partie de la journée, il cherchait par tous les moyens, par la prédication et par le conseil persuasif, à faire redécouvrir aux paroissiens la signification et la beauté de la pénitence sacramentelle, en la montrant comme une exigence intime de la Présence eucharistique (cf. Lettre aux prêtres pour l’Année sacerdotale).
Les méthodes pastorales de saint Jean-Marie Vianney pourraient apparaître peu adaptées aux conditions sociales et culturelles actuelles. Comment en effet un prêtre d’aujourd’hui pourrait-il l’imiter, dans un monde qui a tant changé? S’il est vrai que les temps changent et que de nombreux charismes sont typiques de la personne, et donc inimitables, il y a toutefois un style de vie et un élan de fond que nous sommes tous appelés à cultiver. A bien y regarder, ce qui a rendu saint le curé d’Ars a été son humble fidélité à la mission à laquelle Dieu l’avait appelé; cela a été son abandon constant, empli de confiance, entre les mains de la Providence divine. Il a réussi à toucher le cœur des personnes non en vertu de ses dons humains, ni en s’appuyant exclusivement sur un effort, même louable, de la volonté, il a conquis les âmes, même les plus réfractaires, en leur communiquant ce qu’il vivait de manière intime, à savoir son amitié avec le Christ. Il fut « amoureux » du Christ, et le vrai secret de son succès pastoral a été l’amour qu’il nourrissait pour le Mystère eucharistique, annoncé, célébré et vécu, qui est devenu amour pour le troupeau du Christ, les chrétiens et pour toutes les personnes qui cherchent Dieu. Son témoignage nous rappelle, chers frères et sœurs, que pour chaque baptisé, et plus encore pour le prêtre, l’Eucharistie « n’est pas simplement un événement avec deux protagonistes, un dialogue entre Dieu et moi. La Communion eucharistique tend à une transformation totale de notre propre vie. Elle ouvre avec force le moi tout entier de l’homme et crée un nouveau nous » (Joseph Ratzinger,La Communion dans l’Eglise).
Alors, loin de réduire la figure de saint Jean-Marie Vianney à un exemple, même admirable, de la spiritualité dévotionnelle du XIXe siècle, il est nécessaire au contraire de saisir la force prophétique qui distingue sa personnalité humaine et sacerdotale d’une très grande actualité. Dans la France post-révolutionnaire qui faisait l’expérience d’une sorte de « dictature du rationalisme » visant à effacer la présence même des prêtres et de l’Eglise dans la société, il vécut, d’abord – pendant sa jeunesse – une clandestinité héroïque en parcourant des kilomètres dans la nuit pour participer à la Messe. Puis – comme prêtre – il se distingua par une créativité pastorale singulière et féconde, en mesure de montrer que le rationalisme, qui régnait alors sans partage, était en réalité loin de satisfaire les authentiques besoins de l’homme et qui, en définitive, n’était pas vivable.
Chers frères et sœurs, à 150 ans de la mort du saint curé d’Ars, les défis de la société d’aujourd’hui ne sont pas moins difficiles, ils sont même devenus peut-être plus complexes. Si à l’époque régnait la « dictature du rationalisme », à l’époque actuelle, on note dans de nombreux milieux, une sorte de « dictature du relativisme ». Elles apparaissent toutes deux comme des réponses inadaptées au juste besoin de l’homme d’utiliser pleinement sa propre raison comme élément distinctif et constitutif de son identité. Le rationalisme fut inadapté parce qu’il ne tint pas compte des limites humaines et prétendit élever la seule raison comme mesure de toute chose, en la transformant en déesse; le relativisme contemporain mortifie la raison, parce que, de fait, il en vient à affirmer que l’être humain ne peut rien connaître avec certitude au-delà du domaine scientifique positif. Mais aujourd’hui, comme alors, l’homme « assoiffé de signification et d’accomplissement » va à la recherche constante de réponses exhaustives aux questions de fond qu’il ne cesse de se poser.
Les Pères du Concile œcuménique Vatican II avaient bien présents à l’esprit cette « soif de vérité » qui brûle dans le cœur de tout homme, lorsqu’ils affirmèrent que c’est aux prêtres, « comme éducateurs de la foi », qu’il revient de former « une authentique communauté chrétienne » capable de « frayer la route à tous les hommes vers le Christ » et d’exercer « une véritable maternité » à leur égard, en indiquant ou en facilitant à celui qui ne croit pas « un chemin vers le Christ et son Eglise » et « pour réveiller les fidèles, les nourrir, leur donner des forces pour le combat spirituel » (cf. Presbyterorum ordinis, n. 6). L’enseignement que continue de nous transmettre le saint curé d’Ars à cet égard est que, à la base de cet engagement pastoral, le prêtre doit placer une union personnelle intime avec le Christ, qu’il faut cultiver et accroître jour après jour. C’est seulement s’il est amoureux du Christ que le prêtre pourra enseigner à tous cette union, cette amitié intime avec le divin Maître, qu’il pourra toucher les cœurs des personnes et les ouvrir à l’amour miséricordieux du Seigneur. C’est seulement ainsi, par conséquent, qu’il pourra transmettre enthousiasme et vitalité spirituelle aux communautés que le Seigneur lui confie. Prions pour que, par l’intercession de saint Jean-Marie Vianney, Dieu fasse don à son Eglise de saints prêtres, et pour que croisse chez les fidèles le désir de soutenir et d’aider leur ministère. Confions ces intentions à Marie, que nous invoquons précisément aujourd’hui comme Vierge des Neiges.
MARIE VIANNEY
La maman de Jean Marie Baptiste Vianney, le saint Curé d’Ars
Lui-même a attribué aux prières de sa mère, après Dieu, tout ce qu’il a été.
Marie était la fille de pieux paysans du nom de Béluse, d’Ecully près de Lyon, un petit village qui devait avoir plus tard une grande importance dans l’histoire du saint curé. En 1778 elle épousa Mathieu Vianney, de Dardilly. Ils eurent la joie d’accueillir dans leur foyer trois fils et trois filles.
Marie Vianney nous est décrite comme une femme d’un grand charme et d’une certaine délicatesse dans son extérieur et ses manières. Dans ses rapports avec les autres, dans son langage, dans toute sa manière d’être, il y avait quelque chose qui dépassait le niveau d’une simple paysanne. Le reflet de son cœur profond et noble était répandu sur toute sa personne.
Elle était pénétrée d’une piété dénuée d’affectation. Une grâce circulait entre elle et ses enfants à qui elle apprenait à prier et à louer Dieu, non seulement par ses paroles, mais par son exemple spontané. Chez tous ses enfants, cette éducation porta des fruits abondants. La fille aînée, Catherine épouse Melin, mourut jeune et sans enfants. Le fils aîné, François, eut une vie longue et exemplaire. Il se distinguait par sa profonde soumission à la volonté de Dieu. Se plaignait-on en sa présence du mauvais temps lors de la moisson, il disait simplement : «Hé quoi, celui qui a mouillé la terre peut aussi la sécher.». Nous trouvons la même pureté et la même clarté dans la vie du dernier des fils, et d’une fille demeurée célibataire, Marguerite, qui survécut à son frère Jean-Marie. Le sixième enfant était mort tout petit.
Jean-Baptiste était le quatrième des six enfants. C’est dans ses entretiens avec son petit Jean-Marie que le caractère de la mère trouva son plus bel épanouissement. Lorsqu’elle le portait encore dans son sein, elle l’offrit à Dieu et à sa Mère d’une façon particulière. Elle fit vœu, si Dieu l’appelait au sacerdoce, de tout faire pour lui permettre d’atteindre ce but. A cause de cette espérance, elle donna à l’enfant, en plus de son prénom, celui de Marie.
« Mon petit Jean-Marie, si je te voyais offenser le bon Dieu, cela me ferait plus de peine que si c’était un autre de mes enfants », lui disait-elle plus tard. Il ne se doutait pas que cette sollicitude particulière venait de son désir de l’aider s’il devait un jour être prêtre.
A 18 mois, l’enfant savait prononcer les noms de Jésus et de Marie, et mettre ses mains jointes dans celles de sa mère lorsqu’elle priait. Le saint curé a toujours attribué à sa mère son précoce amour de la prière. Le premier cadeau qu’elle lui fit fut une statuette en bois de la Vierge, dont il ne voulut plus se séparer, même pour se coucher. S’il pleurait, ce qui arrivait rarement, la mère lui mettait dans la main une image de saint ou un chapelet, et ses larmes s’arrêtaient.
Mais il ne fallait pas que ces objets devinssent pour lui un fétiche ou un objet d’avarice enfantine. Un jour que sa sœur désirait vivement son beau chapelet, la mère lui dit tout de suite d’accéder à son désir pour l’amour de Dieu. Il le fit, quoique non sans larmes, comme il le racontait encore dans sa vieillesse. La mère ne voulait pas non plus que la dévotion dégénère en excentricité. Aussi fut-elle fort émue lorsqu’un voisin, qui n’était pas des plus dévots, lui demanda un jour en plaisantant si son brunet le tenait pour le diable. « Il se tue de faire des signes de croix en ma présence ». La mère demanda immédiatement des explications à l’enfant. Celle qu’il fournit la rassura : il n’avait pas vu le voisin et avait fait le signe de croix en commençant et en finissant une prière muette.
Une autre fois – il avait quatre ans – il s’était caché à l’étable où il priait, immobile, agenouillé dans un coin. Après de longues recherches, sa mère le trouva et fut très émue. Mais elle ne voulait pas le montrer et lui demanda, d’un ton de reproche : « Pourquoi m’as-tu donné tant d’inquiétude ? Quelle idée de te cacher comme cela ! ». L’enfant n’y avait pas réfléchi. Il se jeta en pleurant dans les bras de sa mère en répétant, au milieu de ses sanglots : « Mère, pardonnez-moi, je n’ai pas voulu vous faire de la peine. Je n’y retournerai plus, je n’y retournerai plus. » Cette petite scène éclaire d’une vive lumière les rapports entre la mère et l’enfant.
Ce n’est pas seulement dans la piété et la soumission à Dieu que Marie Vianney était pour ses enfants un exemple entraînant. Elle n’oubliait jamais que l’amour du prochain a été mis par le Christ lui-même au même niveau que l’amour de Dieu. Ses propres penchants se rencontraient avec la tradition de la famille Vianney, où l’on avait toujours pratiqué une charité étonnante pour de petits paysans. Tous ceux qui frappaient à la porte recevaient à manger. A l’époque de la Révolution, la misère prit des proportions énormes. Il arrivait alors que vingt pauvres frappent à la fois à la porte de l’hospitalière maison ; on les couchait dans la grange, sur le foin ou la paille. La mère faisait cuire pour tout le monde, dans la cheminée, une grande marmite de soupe ou de pommes de terre, aliment encore assez rare à l’époque. Toute la famille récitait le Bénédicité avec les pauvres et mangeait avec eux. Les enfants devaient les servir. Lorsque tout le monde était à peu près rassasié, le père se mettait à parler de choses spirituelles, bien secondé par son jeune fils, tandis que la mère, aidée de ses filles, desservait et lavait la vaisselle.
Ainsi la vie s’écoulait dans la prière et le travail, les soucis et les joies. De même que la mère elle-même s’activait dans la maison, au jardin, aux champs, elle exigeait la même chose de ses enfants. Elle n’exceptait nullement du précepte du travail le fils qu’elle avait particulièrement offert au Seigneur. Au contraire, elle y veillait spécialement. Elle n’élevait aucune protestation lorsque le petit garçon, encore tout jeune, avait à garder les bêtes de son père – quatre ou cinq vaches, un âne, trois moutons. Il emportait sa statuette de la Vierge, pour être sous la protection de Marie. Il dut aussi, comme son frère de deux ans plus âgé, aider de bonne heure au labourage et aux autres travaux des champs. Enfin c’était la vie de toute maison paysanne.
Mais lorsque la vocation de l’enfant le porta plus nettement vers le sacerdoce, que le vieux curé Belley en parla avec insistance et encouragea les parents à lui faire faire ses études, ce fut la mère qui, la première, consentit avec joie. Le père hésitait malgré sa grande piété. L’avenir d’un prêtre, en ce temps là, lui apparaissait trop incertain. La mère dut finalement consentir à différer encore un peu le projet. Lorsque fut conclu le Concordat entre Napoléon et l’Eglise, en 1801, toute hésitation disparut.
Une épreuve nouvelle attendait le jeune homme, et en même temps ses parents. Par suite d’une erreur, il n’avait pas été inscrit sur la liste des étudiants en théologie ; il fut en conséquence appelé au service militaire, et, par un enchaînement de circonstances malheureuses, il fut soupçonné d’être déserteur. Il lui fallut se tenir caché, et longtemps les parents restèrent sans nouvelles de lui. La mère en tomba malade de chagrin, jusqu’à ce qu’enfin la noble dame chez qui son fils avait trouvé asile vint la trouver et la rassurer. Alors elle retrouva la vie. Elle ne se lassait pas de s’enquérir de tous les détails de son existence, et ne voulut pas laisser partir sa bienfaitrice avant qu’on ait trouvé une messagère entre la mère et le fils. Que cette simple paysanne sût lire et écrire, c’est là une preuve d’instruction exceptionnelle pour l’époque. L’année suivante, son plus jeune fils se présenta au service militaire comme remplaçant de son frère. Il fut accepté, et Jean-Baptiste put rentrer dans son pays.
Ce qui avait d’abord paru un évènement heureux devint pour la mère une douleur nouvelle. Le plus jeune fils fut tué à la guerre au début de 1813. Elle connut une seconde fois la douleur de perdre un enfant.
Elle ne devait plus jouir bien longtemps du développement spirituel de plus en plus fécond de son Jean-Marie. Certes, elle avait été pleine de joie lorsqu’il rentra d’exil et put reprendre ses études auprès du vieux curé d’Ecully. Mais ses forces étaient brisées. Elle ne vécut pas assez pour voir son fils séminariste. Nous ne savons rien de précis sur sa mort.
Son fils disait qu’un enfant ne devrait pas regarder sa mère sans pleurer, et que la vertu passait du cœur de la mère dans celui de l’enfant. Ces paroles disent quel cœur maternel aimant et vraiment chrétien a battu dans la poitrine de cette simple paysanne.
***
La statuette de Marie
Jean-Marie a 4 ans
Jean-Marie a 4 ans. Il possède un joli chapelet auquel il tient beaucoup.
Gothon, sa sœur plus jeune de 18 mois, veut l’avoir.
Une dispute éclate entre le frère et la sœur : cris et trépignements…
Gothon : – Donne-moi !
Jean-Marie : – Non, c’est à moi !
Gothon : – Je le veux !
Jean-Marie : – Non ! C’est à moi !
Gothon : – Donne, donne ! Je le veux !
Jean-Marie appelle maman au secours :
– Maman, Gothon veut me prendre mon chapelet !
Maman lui dit :
– Mon petit Jean-Marie, donne ton chapelet à Gothon. Donne-le pour l’amour du bon Dieu.
Aussitôt, Jean-Marie, sanglotant, tend le chapelet à Gothon.
Pour sécher ses larmes, maman lui fait cadeau d’une petite statue de la sainte Vierge en bois qui était sur la cheminée de la cuisine.
Jean-Marie est très heureux. Il ne peut plus s’en séparer ni le jour ni la nuit. Il n’aurait pas dormi tranquille s’il ne l’avait pas eue à côté de lui dans son petit lit.
Quelquefois on voit Jean-Marie se placer dans un coin de la maison et déposer sa chère statuette sur une chaise ou un tabouret. Alors, il prie devant elle avec un grand recueillement. Il sait que ce n’est qu’une statue, mais qui lui rappelle la présence invisible mais réelle de Marie, Maman de Jésus et sa Maman.
Un soir, Jean-Marie sort sans rien dire. Sa maman s’aperçoit de sa disparition. Elle le cherche dans la maison, l’appelle.
- Jean-Marie, où es-tu ? Réponds-moi. Où es-tu ?
Aucune réponse. Inquiète, maman Vianney cherche le petit dans la cour, puis se dirige vers l’étable. Là, dans un coin d’ombre, elle le découvre, agenouillé entre deux animaux qui ruminent paisiblement. Jean-Marie prie, les yeux fermés, les mains jointes sur sa statuette de Marie.
Maman Vianney s’approche et serre Jean-Marie sur son cœur en lui disant :
- ô mon petit, tu étais là ? Je t’ai cherché ! J’étais si inquiète !
- pardon, maman, je ne savais pas. Je ne l’ai pas fait exprès.
***
Comment Maman Vianney apprend à ses enfants à « bénir l’heure »
Maman Vianney apprend à ses enfants à « bénir l’heure ».
– Mes enfants, dès qu’une heure sonne à l’horloge, pensez à Dieu, parlez-lui, demandez-lui de bénir ce que vous allez faire, offrez-lui votre travail ou votre jeu…
Aussi, où qu’il soit, à la maison, dans le jardin, dans la rue, Jean-Marie, dès que l’heure sonne, fait silence et parle à Dieu, parle à Marie…
***
Le petit Jean-Marie accompagne Maman Vianney à la Messe
Maman Vianney va presque chaque jour à la Messe du matin. Quand la sonnerie de la cloche de l’église toute proche annonce la Messe, Jean-Marie appelle sa maman :
- ô maman, emmène-moi à l’église. Je veux aller avec toi à la Messe. S’il te plaît, maman !
- d’accord, habille-toi vite mon Jean-Marie !
Maman Vianney est heureuse d’emmener son Jean-Marie à la Messe. Elle le prend tout près d’elle et lui explique tout bas les différents moments.
- Maintenant, c’est le Kyrie. On dit « Seigneur, prends pitié » pour demander pardon à Dieu pour notre manque d’amour.
- Maintenant, on écoute la Parole de Dieu, ce que Jésus a fait et ce qu’il a dit.
- Maintenant, on offre à Dieu le pain et le vin, fruit du travail des hommes pour qu’il les transforme en son Corps et en son Sang. Et on lui offre toute notre vie pour qu’il la transforme en amour.
- Maintenant, le prêtre montre le Corps du Christ. Tu dis dans ton cœur : « Jésus, c’est toi ! Je t’adore et je t’aime. »
Jean-Marie regarde avec envie l’enfant de chœur qui sert la Messe. Il voudrait faire pareil. Mais il est encore trop petit.
***
La première confession de Jean-Marie
Jean-Marie a 11 ans.
Pendant la révolution, les prêtres sont en péril. Ils doivent se cacher. Un jour, Monsieur Groboz, prêtre qui se cache en se faisant passer pour un cuisinier, est de passage en cachette à la ferme des Vianney. Le soir, il bénit les enfants l’un après l’autre : Catherine, François, Marguerite, François le cadet… Il interroge Jean-Marie :
– Quel âge as-tu ?
– Onze ans
– Depuis quand ne t’es-tu pas confessé ?
– Je ne me suis encore jamais confessé.
– Eh bien, faisons cela tout de suite.
Jean-Marie reste seul avec le prêtre. Le prêtre s’assoit sur une chaise. Jean-Marie se met à genoux à côté de lui au pied de l’horloge et fait sa première confession. Quel bonheur pour lui ! Il sait qu’à travers le prêtre, Jésus lui donne son pardon et tout son amour !
***
La première communion de Jean-Marie
Jean-Marie a 13 ans
Pendant la révolution, il faut se cacher pour prier. Jean-Marie a treize ans. Il va enfin pouvoir faire sa première communion. C’est dans ce contexte de la Révolution qu’il évolue. Certains soirs, à la tombée de la nuit, sa mère rassemblait ses enfants et les emmenait secrètement. Elle avait appris qu’un missionnaire – on ignorait même son nom – était de passage dans une ferme.
Voici comment Mgr Trochu évoque cette période tourmentée. : « Les Vianney partaient le soir sans bruit et ils marchaient parfois longtemps dans les ténèbres. Jean-Marie, tout heureux d’aller à cette fête, allongeait vaillamment ses petites jambes. Ses frères et ses soeurs murmuraient quelquefois, trouvant la distance exagérée, mais leur mère leur disait : « Imitez donc Jean-Marie qui est toujours empressé ». Arrivés à l’endroit convenu, on les introduisait dans une grange ou dans une chambre retirée, éclairée à peine. Près d’une pauvre table, priait un inconnu aux traits fatigués, au suave sourire. Les mains accueillantes, il s’avançait vers les nouveaux venus. Puis, dans l’angle le plus reculé, s’échangeaient des confidences. Derrière un rideau de fortune, à voix très basse, le bon prêtre conseillait, rassurait, absolvait les consciences. Quelquefois aussi, de jeunes fiancés demandaient qu’on bénît leur mariage. Enfin, c’était la messe tant désirée des grands et des petits. Le prêtre disposait sur la table l’ardoise consacrée qu’il avait apportée avec lui, le missel, le calice et plusieurs hosties, car il ne serait pas seul à communier cette nuit-là ; il se revêtait à la hâte de ses ornements plissés et ternis. Puis, au milieu d’un silence profond, il commençait les prières liturgiques : « Je monterai à l’autel du Seigneur ». Quelle ferveur dans sa voix et, dans l’assistance, quel recueillement, quelle émotion ! Combien fut remuée, en ces minutes inoubliables, l’âme du petit Vianney. ». Jean-Marie regardait, participait. Il avait sous les yeux le visage de ces prêtres héroïques qui risquaient leur vie.
C’est dans ces conditions qu’il fit sa première communion à Ecully dans la maison aux volets clos de Mme Pingon de bon matin, avec des chars de foin devant les fenêtres, que des hommes s’employaient à décharger tranquillement pour éviter d’éveiller toute curiosité. Jean-Marie Vianney avait alors treize ans passé.
De très bon matin, les 16 communiants de Dardilly sont conduits séparément sous leurs habits ordinaires dans une grande chambre de la maison de Mme Pingon. Les volets sont fermés, car il ne faut pas que du dehors on aperçoive la lueur des cierges des communiants. Par précaution, devant les fenêtres, on a rangé des charrettes de foin, et pendant la cérémonie, les hommes travaillent à les décharger pour que l’on ne se doute de rien. Les mères apportent, dissimulés sous leurs longues capes, les voiles et les brassards blancs. Chacune apprête son enfant pour la visite de Jésus.
Pendant la Messe, chacun prie de tout son cœur.
Après la communion, Jean-Marie est si content qu’il ne pense pas à sortir de la chambre où il a eu le bonheur de communier pour la première fois. Il faut que maman l’appelle :
- Viens, Jean-Marie, il faut partir.
- « O mon Dieu ! quelle joie pour un chrétien qui s’en va avec tout le Ciel dans son cœur ! » dira Jean-Marie plus tard quand il sera prêtre.
***
Jean-Marie aux champs avec la statue de Marie
Quand Jean-Marie approche des 13 ans, il doit laisser à Gothon et à François Cadet la garde du troupeau et aider aux cultures. Le premier jour, quand il va avec son frère François travailler à la vigne, il a beau vouloir avancer autant que son aîné âgé de 18 ans, le soir il rentre exténué.
Jean-Marie : – Je me suis épuisé à vouloir suivre François.
Maman Vianney : – François, va donc moins vite, ou bien aide-le un peu.
François : – Oh ! Jean-Marie n’est pas obligé d’en faire autant que moi. Que diraient les gens si l’aîné n’avançait pas plus vite que le cadet ?
Le lendemain, une religieuse de Lyon passe à la ferme des Vianney. Elle donne à chacun une image. Elle a aussi une petite statue de la Sainte Vierge dans un étui. Elle en fait cadeau à Jean-Marie.
Quand Jean-Marie retourne travailler à la vigne avec François, avant de se mettre au travail, il baise les pieds de la statue, puis la jette devant lui aussi loin qu’il le peut. Quand il l’a atteinte, il la prend avec respect et recommence.
De retour à la maison le soir, il dit à Maman Vianney :
– Maman, aie toujours bien confiance en la Sainte Vierge. Je l’ai bien invoquée aujourd’hui et elle m’a bien aidé : j’ai pu suivre mon frère et je ne suis pas trop fatigué.
***
Le grand au milieu des petits Jean-Marie a 19 ans.
Papa Vianney a enfin accepté que son fils de 19 ans quitte la ferme familiale pour se préparer à devenir prêtre. Jean-Marie commence ses études de séminariste au presbytère d’Ecully avec l’Abbé Balley.
Sans sa faute, sa mémoire s’était rouillée. Il ne retient pas le latin qu’il apprend. Il travaille avec les enfants Loras et le fils Deschamps qui ont 12 et 13 ans. L’Abbé Balley demande aux élèves d’aider Jean-Marie à apprendre la grammaire latine. Un jour, Matthieu Loras, énervé par les incompréhensions de Jean-Marie, le gifle en présence des autres élèves : « espèce d’âne ! ». Jean-Marie a envie de rétorquer, mais il se met à genoux devant cet enfant qui vient de le frapper et lui demande pardon :
– Pardonne-moi, Matthias, je te donne trop de peine. Rien ne veut entrer dans ma caboche.
Mathieu qui avait bon cœur mais qui manquait de patience, touché jusqu’aux larmes, tombe dans les bras de Jean-Marie encore agenouillé :
– Oh ! Jean-Marie, c’est moi qui te demande pardon. Tu es le dernier pour le latin mais le premier par le cœur !
***
Le prêtre au milieu de sn peuple.
Jean-Marie Vianney, on le sait, commença par passer de longues heures d’adoration devant le Saint-Sacrement. Mais, en même temps, il allait systématiquement visiter les paroissiens. C’était, à l’époque, une véritable révolution ! Le Père Nodet décrit la pastorale du Curé d’Ars: « Jean-Marie Vianney s’était lié corps et âme à ses gens d’Ars. Sa prière était leur prière. Leur labeur était son labeur. Ce fut une attitude étonnante pour les curés, ses voisins, qui étaient persuadés que la perfection était de rester dans leur presbytère à l’ombre de l’église pour y prier, y étudier, quand ils en avaient le goût, et cultiver leur petit jardin traditionnel. Ils attendaient que la cloche fêlée suspendue à la porte d’entrée, s’agite pour qu’ils se donnent le droit de se pencher sur les difficultés ou les projets de quelque paroissien. Ce n’était qu’en « cas d’urgence » qu’ils considéraient comme une obligation d’aller les voir. Jean-Marie, qui avait longtemps vécu du travail de la terre, avait senti qu’il était souhaitable de changer la tradition. Dès son arrivée, il avait prétendu connaître tous ses gens et les connaître chez eux. À l’heure de midi et contre toutes les habitudes, il allait visiter les familles les unes après les autres. En pénétrant dans la cour, il appelait, de sa voix éraillée, le maître de maison par son prénom et, avant que l’émotion ne fût retombée autour de la table, il entrait de son pas rapide, priait tous les présents de se rasseoir et de poursuivre leur repas qui fumait discrètement dans chaque écuelle. Debout, appuyé sur un bahut ou sur le rebord d’une fenêtre, il parlait à ces pauvres gens des travaux en retard, des méfaits de la grêle ou de la gelée, des bêtes qu’il avait entendu remuer en passant devant l’écurie.
Puis, insensiblement, il en venait à parler des enfants. Alors, il engageait les parents à ne pas gronder toujours mais à prendre conscience de leur responsabilité. « Vos enfants se souviendront bien plus de ce que vous aurez été que de ce que vous aurez dit. ».
Il s’aperçut bientôt du manque total d’instruction des enfants du village. La plupart ne savaient ni lire, ni écrire, pas même signer leur nom. A ses yeux, l’ignorance était l’une des plus grandes pauvretés. Il prit le parti de lutter contre elle. Dans le minuscule village d’Ars, il ouvrit une école pour les filles, puis une pour les garçons. Mais surtout, il fut profondément touché par la misère de ces petites filles et de ces adolescentes que l’on rencontrait le long des chemins. Abandonnées par leurs parents, elles allaient de ferme en ferme chercher de quoi manger et où se loger. La tourmente révolutionnaire, les guerres de Napoléon, l’instabilité politique avaient provoqué d’immenses détresses dans la population. Jean-Marie Vianney se fit donc maçon ! Il transforma une ancienne maison qu’il avait achetée et y accueillit gratuitement toutes les orphelines de la région, avec le concours de trois jeunes filles d’Ars. Ce fut le fameux orphelinat de la « Providence ». Il y reçut jusqu’à 80 pensionnaires.
Il serait trop long de rappeler ici tous les aspects de sa pastorale. L’action du nouveau curé fut considérable et transforma le village. Ses prédications impressionnaient. L’un des points sur lesquels il insistait régulièrement était le repos du dimanche. « Le dimanche, c’est le bien du Bon Dieu. C’est son jour à lui, le Jour du Seigneur. Il a fait tous les jours de la semaine, il pouvait les garder tous : il vous en a donné six, il ne s’est réservé que le septième. De quel droit touchez-vous à ce qui ne vous appartient pas ? Vous savez que le bien volé ne profite jamais. Le jour que vous volez au Seigneur ne vous profitera pas non plus. Je connais deux moyens bien sûrs de devenir pauvre: c’est de travailler le dimanche et de prendre le bien d’autrui. ».
Il avait remarqué que les femmes surtout n’avaient jamais un instant de répit le dimanche. Il invita alors les familles à faire « un maximum de travail le samedi, afin de pouvoir se reposer le dimanche. » « Il y a en a, disait-il, qui font exprès et laisseront tomber beaucoup de choses à arranger dans la semaine pour les faire le dimanche, comme nettoyer, ranger, plier le linge dans une armoire. Il faut au contraire faire tout ce que l’on peut le samedi, pour être libre le dimanche ».
De leur côté, les domestiques et les journaliers, sous la pression des propriétaires, étaient constamment à la tâche. Les interventions du curé finirent par produire leurs effets. Un nommé Rousset, fermier du petit domaine du château, déclara que ses domestiques ne travailleraient plus le dimanche. Ce geste fut imité par presque la totalité des gros fermiers, qui n’en diminuèrent pas pour autant le salaire de leurs employés. Il est évident que les domestiques de tout le pays l’apprirent et réclamèrent leur dimanche à leur patron.
La vie de famille retrouva ses droits. De même, la disparition des cabarets dans le village eut pour effet de diminuer le nombre des alcooliques; les hommes rentraient le soir à la maison sans violence ni agressivité. L’atmosphère dans les familles s’en ressentit fortement.
C’est ainsi que Jean-Marie Vianney, sans l’avoir expressément voulu, en ne recherchant que le bien des âmes, fit oeuvre sociale. Il s’ingénia à prendre des initiatives adaptées à son temps et à ses paroissiens, relevant ainsi le défi évangélique de son époque. Mais il le fit toujours comme « pasteur », et non comme « agent social » préoccupé du seul bon ordre de la société. Si Jean-Marie Vianney fut très proche de ses paroissiens, ce fut toujours « dans une perspective qui était celle de leur salut et du progrès du Royaume de Dieu ». Car le prêtre est le témoin et le dispensateur d’une vie autre que la vie terrestre. Il est essentiel à l’Église que l’identité du prêtre soit sauvegardée, avec sa dimension verticale. La vie et la personnalité du Curé d’Ars en sont une illustration particulièrement éclairante et vigoureuse.
Telle fut une des caractéristiques du ministère de Jean-Marie Vianney comme curé. Les saints ont ce pouvoir de transformer la vie dans ses plus humbles réalités, en étant simplement imprégnés de la vie de Dieu.
C’est pour cette raison profonde que le Curé d’Ars est devenu « un modèle sacerdotal pour tous les pasteurs ». Le secret de sa générosité se trouve dans son amour de Dieu, vécu sans mesure. Significative est sa dernière prière, au soir de sa vie:
« Ô mon Dieu, j’aime mieux mourir en vous aimant,
que de vivre un seul instant sans vous aimer. »